Joëlle Proust – Penser vite ou penser Bien ?
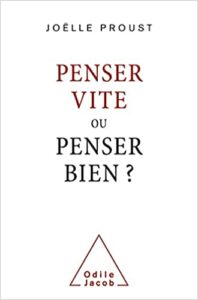
Ce livre est très intéressant mais…
Comme point de départ et fil conducteur, l’auteur présente les trois types d’action où la pensée se manifeste :
* l’action réactive, où l’on doit prendre une décision vite, face à un événement inattendu, p. exemple, un bébé qui risque de tomber de sa chaise;
* l’action habituelle, des actions répétitives telles la préparation du petit déjeuner le matin;
* l’action stratégique, comme par exemple, planifier les vacances ou la recherche d’un prochain emploi.
A chacune de ces situations ce sont des mécanismes cognitifs différents qui sont mis en œuvre. Et on retrouve le compromis dans le titre du livre : « Penser vite ou penser bien ? ».
L’auteur détaille le fonctionnement de tous ces mécanismes et comment ils évoluent de la naissance à l’âge adulte. Et, c’est bien le titre du livre, s’exercer à trouver le compromis et penser comme il faut quand il faut.
A la fin de la lecture, je me suis posé la question des rapports que l’on pourrait établir entre ce contenu et la théorie de « Système 1 – Système 2 » de pensée proposé par Daniel Kahneman ou encore sur les fonctions Perception/Jugement des Types Psychologiques de Carl Jung.
… mais, j’ai dû faire un effort très important pour arriver jusqu’au bout et j’ai sauté quelques parties (pas honte de le dire).
C’est un livre écrit par une philosophe sur des sciences cognitives et que j’ai trouvé dans le rayon psychologie d’une grande librairie. C’est un livre à cheval sur la philosophie et la psychologie, mais je doute qu’un psychologue trouvera la lecture agréable ou aisée.
L’écriture de certaines parties (mais pas toutes) est remplie d’un jargon assez spécifique et difficile. Parfois avec des écarts par rapport à des définitions que l’on trouve dans les dictionnaires. Je cite deux exemples.
1/ « Cohérence » (p. 179) – Attention, le terme de « cohérence » a ici un sens technique, à distinguer de la consistance, c’est-à-dire la compatibilité logique entre deux énoncés ! Par cohérence, on entend le sentiment métacognitif de facilité de traitement qui est induit par la fluence d’un discours ou d’un document. Bon… il faut faire attention à des détails de ce genre pendant toute la lecture. C’est fatigant.
2/ « Feedback » (p.32-36) – L’auteur utilise le terme anglais alors qu’il existe bien une traduction : Rétroaction. Ceci est un concept très profondément étudié en sciences exactes mais qui s’applique partout : en automatique, robotique, économie, biologie, sociologie, psychologie, … Partout même. Mais je crains qu’elle a tort surtout quand elle parle des systèmes en boucle ouverte versus les systèmes en boucle fermée.
La notion de « feedback » dans son livre est passagèrement expliquée, mais complètement erronée lorsqu’elle parle des systèmes fonctionnant en boucle ouverte. Par définition, il n’y a pas de autorégulation possible en systèmes de boucle ouverte. A partir du moment où l’on accède à des informations autres que celles qui ont déclenché l’action initiale et qu’on les utilise pour mitiger l’action, on est déjà forcément dans un système à boucle fermée. C’est la définition. Et il est important de comprendre cette notion puisque le mot « feedback » revient très souvent tout au long de l’ouvrage. Les pages Rétroaction et Autorégulation de Wikipédia expliquent assez bien ces concepts.
Le contenu est intéressant, le livre est intéressant… Dommage que la lecture soit aussi ardue.
Citations
(p. 7)
Vous avez à prendre connaissance d’un document important pour vous. Préférez-vous le lire à l’écran ou en faire un tirage papier ? Cette décision relève du contrôle de la prise d’information, et fait intervenir le sentiment de comprendre – la « métacompréhension ». On sait aujourd’hui que les écrans favorisent le survol cognitif et l’illusion de comprendre.
(p. 17)
La communication numérique des réseaux sociaux illustre comment de nouvelles actions cognitives peuvent modifier en profondeur la capacité individuelle et collective de penser. Les règles de base de la communications numérique sont la réactivité et la popularité : les actions cognitives impulsives en forment le support naturel. Les jugements les plus tranchés, les plus simples, sont les plus susceptibles de recueillir l’adhésion. Ils deviennent rapidement une norme partagée. Un nouveau métier est apparu, celui d’influenceur. Son rôle est de vous encourager à partager sur les réseaux sociaux vos réactions spontanées et irréfléchies. Se joue ici un combat souterrain : l’influenceur vise à élever la bonne opinion publique sur un produit. Mais comme il joue sur la dimension réactive de la pensée, il ne se sert pas d’arguments. Il utilise vos réponses émotionnelles.
Quatrième de couverture
D’où viennent nos stratégies de pensée?? Pourquoi est-on curieux, pourquoi ne veut-on rien savoir, pourquoi a-t-on l’impression d’avoir raison là où on a tort?? Penser par soi-même suppose de savoir ce que l’on sait ou ne sait pas, de choisir entre les arguments valides et les faux-semblants. Mais comment faisons-nous le tri, dans le feu des urgences?? Spontanément, avant toute réflexion, telle affirmation nous paraît plausible, telle autre indubitable.
Ce livre montre que la décision comporte une part émotionnelle qui dicte ce qu’il faut approfondir ou négliger, qui discerne si nous pouvons nous rappeler un nom, résoudre un problème, gagner une partie d’échecs. Mais elle peut être socialement manipulée?: encourager nos réactions spontanées, réduire nos capacités critiques, étouffer celles de nos enfants. Comment résister au déferlement de la pensée impulsive??
En sachant de quoi elle est faite.
Joëlle Proust expose ici le compromis que l’évolution de la pensée et de la cognition nous pousse à négocier à tout instant entre penser vite et penser bien. Elle propose de nouvelles pistes pour aider chacun à éduquer sa capacité de raisonnement, donner aux enfants l’envie d’apprendre, permettre aux agents collectifs de parvenir aux décisions les plus informées, et comprendre pourquoi la postvérité en séduit plus d’un.

