Jean-Pierre Le Goff – La gauche à l’agonie
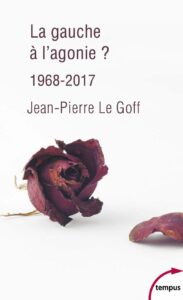
Un livre comme celui-ci, surtout avec ce titre : « La gauche à l’agonie ? » ne peut pas être lu et apprécié sans se renseigner sur l’auteur : son histoire et ses tendances politiques. A ne pas confondre avec l’historien Jacques Le Goff.
Jean-François Le Goff est historien et sociologue. Mai-68 fait parti de son engagement de jeunesse, ainsi que l’extrême gauche post Mai-68. Puis il rencontre, à l’Université de Caen, d’autres sociologues tels Claude Lefort, Marcel Gauchet ou encore Alain Caillé. De cette rencontre naît sa réflexion critique de la gauche et qui constituent le fil conducteur principal de son activité de recherche au CNRS. Comme il le dit :
« Pour ceux qui, comme moi, se sont engagés sans demi-mesure dans l’activisme groupusculaire de l’extrême gauche après mai 68, la fin des illusions et la critique du totalitarisme ont constitué une sérieuse leçon de réalisme et d’humilité. »
Ce livre est un recueil d’articles publiés dans la revue « Débat » et autres. Naturellement, chaque chapitre ou section correspond à thème ou à une époque. Je pense que l’on peut dire qu’il résume l’ensemble de ses travaux.
C’est une critique sans merci et tous les personnages prennent pour leur grade : les intellectuels (Foucault, Deleuze, Guattari, Bourdieu, Badiou, Edwy Plenel, …), les politiciens (Mitterrand, Fabius, Jospin, Mélenchon, Hollande, …).
Mais il n’y a pas que les personnes, il est question aussi de toute la pensée de gauche depuis Mai-68, la pensée des philosophes (on l’a dit), les années Mitterrand, les années Jospin pour finir sur la gauche culturelle des années 10-20 avec les « anti » (racisme, colonialisme, homophobie, genre, fascisme, identité et les avatars « woke » en général) des sujets qui sûrement échappaient à Karl Marx.
On se rend compte que les valeurs de la gauche d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec ceux des années 70, sauf, peut-être une tentative affichée d’humanisme dont on peut parfois se douter de la sincérité.
Je retiens quand même, puisque ça me fait presque sourire, l’impression qui a la gauche de posséder la vérité du concept de Bien et de Mal. Des notions qu’ils défendent bec et ongles avec l’excellente phrase de l’auteur : « À ses pointes extrêmes le gauchisme culturel combine la rage des sans-culottes et le sourire du dalaï-lama. »
Bref, c’est un livre à la charge mais très bien argumenté, écrit par quelqu’un qui sait très bien de quoi il parle. Les sympathisants de droite trouveront ce qu’ils pensent de la gauche et ceux de gauche pourront utiliser ce contenu pour une autocritique salutaire et, je l’espère, un retour aux vrais valeurs humanistes de la gauche.
Avoir une gauche humaniste, cohérente et modérée est indispensable dans notre société. Il faut sortir du populisme à la Mélenchon et de la recherche de bouleversement irrationnel de la société.
Citations
(p.33)
« Pour ceux qui, comme moi, se sont engagés sans demi-mesure dans l’activisme groupusculaire de l’extrême gauche après mai 68, la fin des illusions et la critique du totalitarisme ont constitué une sérieuse leçon de réalisme et d’humilité. À l’époque, la lecture des ouvrages de Claude Lefort, qui avait été l’un de mes professeurs à l’université, m’a beaucoup aidé : elle m’a amené à m’interroger sur les raisons d’un aveuglement, sur les mécanismes idéologiques et les modes de fonctionnement auxquels j’ai moi-même participé ; elle m’a mis en garde contre ceux qui prétendent faire advenir “le meilleur des mondes” en étant persuadés d’en détenir les clés. »
(p.99-100)
Dans « L’anti-Œdipe », Gilles Deleuze et Félix Guattari réinterprètent l’inconscient dans une problématique de renversement de toutes les valeurs et le chargent ainsi d’une fonction subversive à l’égard de l’ordre établi. Les artistes maudits, les schizophrènes, les délinquants et les marginaux sont alors considérés comme les figures types de ce renversement. Ces acteurs sociaux d’un nouveau genre rejoignent la notion de « plèbe » développée à la même époque par Michel Foucault. Cette « plèbe » renvoie aux bandes de jeunes dans les banlieues, aux délinquants, aux prisonniers de croit commun… qui refusent l’ordre, la morale et les lois. Ces « nouveaux plébéiens », souligne alors Foucault, prennent désormais la parole et dénoncent les conditions qui leur sont faites. Du même coup, la marginalité et la délinquance prennent une signification politique.
Au début des années 1970, Foucault pousse au bout la critique : ce sont les notions mêmes de norme, de bien et de mal, d’innocence et de culpabilité qui sont en question. « Évidemment, n’hésite-t-il pas alors à déclarer, les vieux n’ont aucune tendresse particulière pour un type, un jeune délinquant qui leur vole leurs dernières économies parce qu’il veut acheter un Solex. Mais qui est responsable du fait que ce jeune homme n’a pas assez d’argent pour acheter un Solex et, deuxièmement, du fait qu’il a tellement envie d’en acheter un ? » Si le prolétariat est lui aussi victime de la délinquance, sa mésentente avec la « plèbe non prolétaire » semble en fait orchestrée par la bourgeoisie qui craint par-dessus tout l’action directe et violente, comme à tous les moments révolutionnaires de l’histoire passée. Les jeunes délinquants, indique Foucault, sont parfois de jeunes ouvriers, mais ils n’en sont pas moins en rupture avec l' »idéologie do prolétariat ». En fait, la critique de cette « idéologie » se confond avec celle du mouvement ouvrier institutionnalisé, qui, comme tel, serait devenu perméable aux idées bourgeoises.
(p. 279)
En ce sens, la droite se trompe en parlant de nouveau « totalitarisme », même si l’on peut estimer que la gauchisme culture en a quelques beaux restes. En réalité, ce dernier s’inscrit pleinement dans le contexte des « démocraties post-totalitaires » : il puise dans différentes idéologies du passé en décomposition, qu’il recompose à sa manière et fait coexister sans souci de cohérence et d’unité, n’en gardant que des schémas de pensée et de comportement. À ses pointes extrêmes le gauchisme culturel combine la rage des sans-culottes et le sourire du dalaï-lama.
(p.342)
En France, il existe une perte de confiance et une mésestime de soi qui concernent moins les domaines scientifique, technique et économique – encore que les « déclinistes » ne manquent pas -, que les ressources politiques et culturelles liées à sa propre histoire. À vrai dire, la mise à mal de l’histoire nationale a été poussée assez loin. Un nouvel « air du temps » a versé dans une « mémoire pénitentielle » et un règlement de comptes qui n’en finit pas, entretenus par des minorités qui s’érigent en justiciers du passé et encouragent le ressentiment. Les enseignants doivent désormais faire face à cette sous-culture pour laquelle l’absolutisme, l’esclavagisme, le colonialisme, Pétain et la collaboration constituent le résumé succinct de l’histoire de la France, à quoi s’ajoute désormais la vision d’une humanité prédatrice de nature et de l’environnement. Si la jeunesse est bien l' »avenir du monde », elle se trouve soumise à un nouvel endoctrinement, souvent par ceux-là mêmes qui ne cessent d’appeler à son autonomie et à sa créativité, à sa capacité de révolte et d’indignation. Ces réactionnaires d’un nouveau genre bouchent l’horizon de la jeunesse en cherchant vainement la répétition d’une histoire dont ils voudraient demeurer les héros. Le pathétique rejoint le dérisoire au moment même où la dynamique de contestation post-soixante-huitarde qui les a portés est épuisée. Nous sommes arrivés à un point limite où la dénonciation et la réécriture de l’histoire sous l’angle du moralement correct participent d’une détestation mortifère.
Quatrième de couverture
De la révolution matricielle de mai 1968 aux controverses actuelles et aux primaires socialistes, ce livre entend montrer comment la gauche a pu en arriver là. Après avoir scruté les principaux thèmes qui ont structuré son identité depuis le XIXe siècle et constater leur érosion, voire leur décomposition, Jean-Pierre Le Goff met en lumière la fin d’un cycle historique en même temps qu’il souligne les difficultés actuelles d’une reconstruction : le fossé n’existe pas qu’entre générations, il éloigne les couches populaires de la gauche culturelle sur fond d’agonie des idées. Autant de constats qui appellent une réappropriation de notre héritage culturel pour autoriser une reconstruction intellectuelle.

