Delphine Horvilleur – Il n’y a pas de Ajar
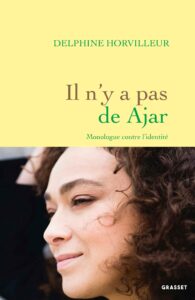
Dephine Horvilleur est un rabbin particulier. J’ai toujours plaisir à lire ses écrits. Celui-ci n’est pas une exception.
Au départ, c’est Romain Kacew, qui a choisi Romain Gary comme nom de plume. En 1974, il invente, comme nom de plume, un autre pseudonyme : Émile Ajar. Comme pour avoir une autre identité. Et c’est l’année de naissance de Delphine Horvilleur.
La réflexion de Delphine a cela comme point de départ : la bagarre pour avoir une identité. Mais laquelle.
Alors, elle imagine un monologue, tenu par Abraham Ajar, le fils de Émile Ajar – ou ce serait plutôt Romain Gary ? Ou encore Romain Kacew ???
Dans d’autres livres elle s’exprime parfois avec humour, l’humour juif. Dans ce livre, elle s’habille dans la peau de Abraham Ajar et se défoule avec beaucoup d’humour. On voit probablement elle même, dans sa vraie identité. Eh oui, il y en a des rabbins qui ont un humour génial.
C’est avec de l’humour qu’elle tourne en dérision la problématique identitaire, sujet de société plus que brûlant.
Ce que je retiens de ce livre est que ceux qui se battent autant à la recherche de la reconnaissance d’une identité sont, parfois des gens qui ont des identités multiples et riches, comme Romain Gary, mais qui insistent à se réduire et à se présenter dans une seule (ou plusieurs) identité, celle la plus fortement victimaire. Et c’est très dommage, surtout pour eux.
Citations
(p.17)
Et dans cette tenaille identitaire politico-religieuse, je pense encore et toujours à Romain Gary, et à tout ce que son œuvre a tenté de torpiller, en choisissant constamment de dire qu’il est permis et salutaire de ne pas se laisser définir par son nom ou sa naissance. Permis et salutaire de se glisser dans la peau d’un autre qui n’a rien à voir avec nous Permis et salutaire de juger un homme pour ce qu’il fait et non par ce dont il hérite. D’exiger pour l’autre une égalité, non pas parce qu’il est comme nous, mais précisément parce qu’il n’est pas comme nous, et que son étrangeté nous oblige.
(p.43)
Tiens, mon père croyait beaucoup à cette idée et il me l’a souvent répeté : pour se comprendre, il ne faut pas parler la même langue. Il faut toujours rester suffisamment incompréhensible pour avoir une chance de ne pas s’entendre et de mieux se connaître.
(p.51)
Jusqu’à l’age de douze ans, il n’a pas dit une seule phrase, pas énoncé la moindre syllabe. Il était muet, comme une carpe. Ses parents, extrêmement inquiets, ont tout essayé pour le faire parler mais rien à faire : pas un mot ne sortait de sa bouche. Et puis un soir, à table, au moment où personne ne s’y attend, il se tourne soudain vers son père et il lui dit :
– Passe moi le sel !
Alors là, tu imagines la stupéfaction familiale. Sa mère explose en sanglots et le couvre de baisers. Le père, bouleversé, lui dit :
– Mon fils, tu sais parler ? Pourquoi as-tu attendu toutes ces années ? Pourquoi n’as-tu rien dit jusqu’à ce soir ?
Et là, le fils répond, très calmement :
– Ben, jusqu’ici, tout allait bien !
Je crois que c’est la pire chose qui puisse arriver dans l’existence : ne manquer ni de sel, ni de tendresse, ni d’amour… parce que alors, il n’y a aucune raison de se mettre à parler, à écrire ou à créer. Si t’es complètement, immanquablement toi-même, alors y’a rien à dire.
(p.67)
– T’as un problème d’antisémitisme ? Tu te connectes à un réseau juif.
– On te fait une réflexion misogyne ? Organise une réunion non mixte.
– T’es victime de racisme, rejoins vite le club racisé le plus proche de chez toi.
– Tu veux traduire un livre, assure-toi que tu partages scrupuleusement le traumatisme de son auteur. Ou sinon, t’abstiens. Capiche ?Et voilà comment plein de gens t’affirment aujourd’hui qu’ils sont complètement eux-mêmes, quand ils ne sont plus qu’un bout d’eux-mêmes, et de préférence le morceau qui a souffert ou a été discriminé. Et d’ailleurs y’a personne d’autre qu’eux mêmes pour les comprendre.
Avant, on rencontrait des gens qui étaient plein de choses à la fois : pied-noir, fils d’immigrés et homosexuel, communiste et gymnaste… ou alors juif-athée-joueur d’échecs et goyophile; eh ben là, c’est fini. Chacun n’est plus qu’un seul truc, catho, gay, vegan, qu’importe, mais exclusivement l’un ou l’autre. Les seuls « combo » qu’on t’autorise c’est quand t’es multi-défavorisé et que tu peux cumuler a priori les discriminations comme des bonus. Mais sinon, tu ne joues plus que dans une seule catégorie et tu es donc sans rapport avec qui que ce soit d’autre. Bien sûr, ça oblige un certain niveau d’entre-soi pour préserver la pureté de l’édifice.
Quatrième de couverture
Dans ce monologue, un homme mystérieux affirme être le fils d’Émile Ajar, pseudonyme sous lequel Romain Gary a écrit notamment « La vie devant soi ».
Cet enfant de père inventé demande à celui qui l’écoute : es-tu le fils de ta lignée ou des livres que tu as lus ?
En interrogeant la filiation et le poids des héritages, il revisite l’univers de l’écrivain, celui de la Kabbale, de la Bible, de l’humour juif… mais aussi les débats politiques d’aujourd’hui, enfermés dans les tribalismes d’exclusion et les compétitions victimaires.
Et si Gary/Ajar étaient les meilleurs antidotes aux obsessions identitaires et mortifères du moment ?

