Georges Didi-Huberman – Sortir du noir
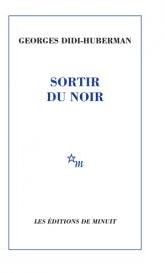 Georges Didi-Huberman est un philosophe dont une partie de ses livres traitent de la philosophie de l’image, mais pas que.
Georges Didi-Huberman est un philosophe dont une partie de ses livres traitent de la philosophie de l’image, mais pas que.
Parmi ces œuvres, certaines concernent les images de la Shoah. Peut-être un hasard de son métier, le premier est peut-être « Images malgré tout », une analyse de quatre photos prises par des juifs du Sonderkommando à Auschwitz – le sens de l’image pour représenter la Shoah. Le sens philosophique de ces photos, d’assez mauvaise qualité, est étudié dans tous les sens.
Puis il y au d’autres. Le livre « Écorces » relate sa visite à Auschwitz avec une photo qui m’a beaucoup touché : une photo toute simple où on voit une clôture de barbelé et un oiseau par terre de l’autre côté et rien d’autre. De cette photo on peut imaginer qu’a pu représenter cet image pour un prisonnier du camp. Mais ça montre aussi l’empathie de l’auteur devant des images, en apparence, toute simples. On peut comprendre que l’auteur est personnellement concerné, par son histoire, par ce qui s’est passé dans ces lieux, il le dit dans un autre livre : « Éparses ».
Ce livre est sorti juste après la sortie du film « Le fils de Saul » de Lazlo Nemes. C’est l’histoire d’un membre du Sonderkommando qui, au moment de vider une chambre à gaz des cadavres des juifs qui venaient d’être assassinés et de les porter aux fours crématoires, il a l’impression d’identifier le cadavre de son fils. Alors, à partir de cet instant, son objectif est de trouver un moyen de sortir le corps de son fils pour l’enterrer avec la présence d’un rabbin que récitera le Kaddish.
Il s’agit bien d’une fiction mais fondée sur la réalité de comment se passait l’assassinat des juifs dans ce complexe de la mort et de ce qui était l’activité des membres du Sonderkommando.
Attentif à l’image, rien ne lui échappe, et en particulier le choix du cinéaste de pratiquement tout filmer avec un objectif court de 40mm, ce qui oblige l’opérateur de se tenir proche de la scène et des acteurs et de se déplacer avec eux, la plupart du temps. Ça donne un effet terrifiant et très proche de la réalité, comme il le dit, d’ailleurs au tout début du livre.
Un livre tout court, à lire, juste après voir le film.
Citations
(p. 7-8)
Cher László Nemes,
Votre film, Le fils de Saul, est un monstre. Un monstre nécessaire, cohérent, bénéfique, innocent. Le résultat d’un pari esthétique et narratif extraordinairement risqué. Comment un film ayant pour objet le Béhémoth bien réel que fut la machine d’extermination nazie dans l’enclos d’Auschwitz-Birkenau en 1944 ne serait-il pas un monstre du regard des histoires que nous sommes habitués, chaque semaine, à découvrir dans les cinémas sous le nom de « fictions » ? Votre film est-il autre chose qu’une fiction ? Non, bien sûr. Mais c’est une fiction aussi modestement qu’audacieusement accordée au réel historique très particulier dont elle traite. D’où l’épreuve à la découvrir. J’ai eu quelquefois envie, non pas de fermer les yeux, mais de tout ce que vous mettiez en lumière dans ce film retourne, pour un temps si bref soit-il, au noir. Que le film lui-même baisse un instant ses paupières (ce qui arrive quelquefois). Comme si le noir pouvait m’offrir, au milieu de cette monstruosité, un espace ou un temps pour respirer, pour souffler un peu dans ce qui me laissait, d’un plan à l’autre, le souffle si court. Quelle épreuve en effet, que cette mise en lumière : Quelle épreuve que cette foule d’images et que cet enfer de sons rythmant inlassablement votre récit ! Mais quelle épreuve nécessaire et féconde !
Quatrième de couverture
« … il crée de toutes pièces, à contre courant du monde et de sa cruauté, une situation dans laquelle un enfant existe, fut-il déjà mort. POur que nous-mêmes sortions du noir de cette atroce histoire, de ce « trou noir » de l’histoire. »

