Rutger Bregman – Utopies Réalistes
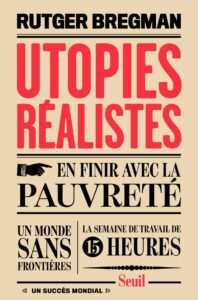
J’ai trouvé ce livre, d’occasion, dans une librairie que je fréquente à Paris. Le titre et les mots de la couverture m’ont attiré l’attention. Puis les titres des chapitres. Si bien que j’ai des doutes de la faisabilité de ces objectifs, j’ai voulu connaître les arguments de l’auteur et de ceux qui défendent ces utopies.
C’est, à première vue, un livre très bien écrit. Beaucoup de références et des chiffres, mais pas de recul, pas d’analyse critique (je reviendrai). Ainsi, le contenu ressemble plus au programme d’un parti politique qu’à un essai. Mais il faut reconnaître que ce livre énumère, grosso modo, les items d’une utopie de gauche.
On s’aperçoit, dès les premières pages, d’un certain biais militant : les références à Karl Marx sont fréquentes tout au long du livre. Ainsi, la recherche d’informations sur différentes sources se révèle utile. C’est valable pour tout type de militantisme.
Le premier thème est « Pourquoi il faut donner de l’argent à chacun ». En fait, c’est le revenu universel ou revenu de base. C’est une idée qui n’est pas exclusivement de gauche. Des nombreuses expérimentations ont été faites, mais très peu (on compte sur les doigts d’une seule main) ont été restées en place. L’auteur affirme que ça existe aux Pays-Bas, mais je n’ai pas trouvé des références ailleurs.
Première remarque : ces expérimentations ne sont pas identiques partout. Les pays ont des cultures et des besoins différents.
La page Wikipédia [1] sur le revenu de base donne beaucoup d’informations sur cette initiative, plus que cet ouvrage.
En fait, ce qui est effectif dans plusieurs pays est une sorte de revenu minimal pour ceux qui sont dans le besoin, un équivalent du RSA français, auquel peuvent s’ajouter des aides diverses et variées.
Prenons le cas du Brésil, pays que je connais bien et dont je vais prendre comme contre-exemple et parler de ce qui se passe là-bas. C’est le « Bolsa Familia ». C’est quelque chose mise en place par Lula dans les années 2000, mais conçue par son prédécesseur. Les raisons électorales ont eu un poids… Il y a presque 50 millions de personnes qui bénéficient. Si on regarde la distribution, dans 13 états sur 27, le nombre de bénéficiaires est supérieur au nombre de personnes avec un contrat de travail, dont 2 pour le double [2]. Comment expliquer cela ? Il y a trois catégories : des bénéficiaires qui sont bien dans le besoin, au chômage ou avec faibles revenus ; d’autres touchant plusieurs aides (électricité, gaz, loyer…) estiment avoir suffisamment pour vivre et préfèrent rester sans travailler ; d’autres font du travail au noir. Il faut savoir que le travail non déclaré est courant au Brésil et on estime que de l’ordre de 40 millions de personnes sont dans ce cas en 2022, soit 42,1% de la population active [3] [4].
Le cas du Brésil est déjà intéressant puisque ça montre plusieurs problèmes : au contraire de ce que dit l’auteur, le bénéficiaire peut ne pas être encouragé à chercher du travail. Ce type d’aide ne devrait pas bénéficier ni ceux qui ne souhaitent pas travailler ni ceux qui font du travail dissimulé. Le travail au noir est un grave problème social et ne devrait pas exister dans une société idéale.
Ensuite… l’auteur propose de « Finir avec la pauvreté », mais pour lui il suffit de fournir un toit pour les sans-abris. Il présente, comme exemple, une expérimentation réussie aux Pays-Bas dans les années 2000 qui a, toutefois, pris fin lors de la crise de 2008. Cela montre la fragilité d’un tel projet : la faible résilience face à un imprévu.
Au Brésil, encore, il y a un programme « Minha casa minha vida » (Ma maison, ma vie). Il s’agit de l’achat aidé par des familles à des revenus modestes (revenu du foyer inférieur à environ cinq salaires minimums). Mais on peut se poser la question de la qualité et la durée de vie des constructions. En France, il y a les HLM (Habitation à Loyer modéré).
Alors qu’il ne parle que de fournir un toit aux sans-abris, pour finir avec la pauvreté va beaucoup plus loin, à moins que son livre ne concerne que la pauvreté dans les pays développés.
Encore le Brésil, prenons le cas des bidonvilles. Ce sont des communautés dans lesquelles les habitations sont construites les unes sur les autres, sans aucun plan d’urbanisme; les branchements : eau, égouts et électricité, quand possibles sont réalisés sauvagement. À cela s’ajoute la sécurité puisque ces communautés sont souvent la source des factions criminelles. Des endroits où même la police ne peut pas entrer. En dehors des bidonvilles, il y a 33 millions de personnes dont les habitations n’ont ni accès à un réseau de distribution d’eau ni à un réseau d’égouts [5] [6]. Au nord-est, on voit des camions citerne qui circulent pour vendre de l’eau. Les égouts sont jetés dans la nature avec tous les risques sanitaires qui vont avec.
Ceci pour dire que pour finir avec la pauvreté, il ne faut pas se contenter de donner un toit aux sans-abris : ceci est peut-être valable dans les pays développés, où des infrastructures existent déjà.
Il y a un chapitre dans lequel le PIB (Produit Interne Brut) est largement critiqué comme seul indicateur de l’état de l’économie d’un pays. Il a raison de le faire, mais il ne parle que du PIB. Il y a des nombreux autres indicateurs. Le IDH (Indice de Développement Humain) de l’ONU, qui tient compte de l’espérance de vie, le niveau d’éducation et des revenus. Mais en fait, il faut aussi considérer un tas d’autres critères : le système de santé, le système éducatif, les infrastructures, la sécurité, la démocratie… et la justice.
J’ai laissé la justice pour la fin puisqu’elle touche la corruption (mais il n’y a pas que la justice). L’auteur cite la Finlande, pays où la qualité de vie est une des meilleures. Il utilise le cas de la Finlande pour justifier qu’il faut que la taille de l’état soit importante pour assurer tous les services. Mais plus la taille de l’état est importante, plus il y a des points d’entrée pour la corruption (surface d’attaque). Si l’on regarde le classement de la perception de la corruption faite par l’ONG Transparence International, on voit que la Finlande est en deuxième position, juste après le Danemark, la France en 25ème et le Brésil en 107ème position [7]. Le Brésil a perdu 13 places entre 2022 et 2024, après le retour de Lula au pouvoir [8] [9]. C’est un mixte de corruption et impunité. C’est impensable mais les projets dits humanistes sont souvent une source de corruption. Ceci pour dire l’importance de la justice dans le combat contre la corruption et l’impunité et, par conséquent, dans le bon fonctionnement de la machine de l’état.
Pour conclure cette partie concernant la pauvreté et les inégalités, sans négliger celle de nos pays européens, il me semble bien plus important de réfléchir à celle des pays émergents ou encore en développement, puisque plus importantes. Il faut bien tenir en compte que la solution des inégalités ne consiste pas juste à traiter la partie visible (donner de l’argent …) : il y a beaucoup de services de l’État qui sont indispensables et qui sont déjà présents dans les pays plus riches mais pas partout. Il me parait, donc, une erreur de vouloir considérer que des solutions uniques et simplistes puissent être appliquées partout dans le monde.
Travailler 15 heures par semaine : « le pied »… Il faut admettre que travailler moins et moins longtemps est un rêve que nous partageons tous. L’auteur parle des apports des nouvelles technologies dans la réalisation des tâches plus difficiles ou pénibles et si de l’idée de « partage du travail » entre les gens de tout âge, y compris ceux qui arrivent aux 80 ans (étonnant), bien sûr selon les envies et possibilités de chacun. Il faut, si l’on veut être réalistes, dans une première approche, imaginer que pour fonctionner, la société a besoin d’un tas de services et de produits et il faut des ressources pour les produire. En fonction de ces objectifs et de la population en âge de travailler, il faut partager le boulot. À cela doit s’ajouter un tas de contraintes. Par exemple, une répartition par métiers demandés sur des travailleurs habilités disponibles pour le réaliser. Une autre contrainte est l’âge de la retraite, sujet plus que brûlant. Dans un système de retraite comme le nôtre, dit de répartition, le revenu des inactifs est payé par des prélèvements dans le salaire des personnes en activité. Avec une augmentation de l’espérance de vie et le vieillissement de la population, soit on augmente les prélèvements, soit on augmente la durée de cotisation (âge de la retraite). Mais revenant à la durée de travail hebdomadaire, il me semble illusoire vouloir fixer cette durée sans tenir compte des besoins de la société. Tout discussion autour de ceci est très conflictuelle et le mieux qu’on peut faire est s’adapter à petits pas. Bref, pas simple.
Cette partie est suivie par un chapitre qui me semble curieux : une charge contre le métier de banquier montrant leur inutilité. Ah… l’éternelle bataille contre le vilain capitalisme et ses figures emblématiques. A vrai dire, je ne vois pas le rapport entre les banquiers et les utopies.
Il y a quand même un chapitre sur les inégalités dans les pays plus pauvres. Le constat est intéressant mais je ne partage pas ses solutions, telles l’ouverture des frontières et laisser venir les migrants… Assez naïf le garçon… Il dit que les arguments pour ne pas le faire sont fallacieux. Mais il n’est pas question de concevoir une utopie pour ces pays.
Il n’est pas inutile de le dire, une fois de plus, la gauche n’a pas le monopole de l’humanisme et du désir de créer un monde meilleur. C’est juste que, sur certains aspects, droite et gauche ne proposent pas les mêmes moyens pour y arriver.
Finalement, c’est un livre bien écrit, l’auteur a fait beaucoup de recherches mais c’est aussi fortement biaisé. D’une naïveté et d’un idéalisme qui me laissent perplexe. Mais bon, ça reste mon avis personnel.
Une lecture intéressante concernant les inégalités et, surtout, celle de ceux qui sont au plus bas est le livre « L’homme inutile » de Pierre-Noël Giraud, un économiste, professeur à l’École des Mines de Paris, qui a beaucoup travaillé sur le sujet.
Références
[1] Revenu de base
[2] 13 Estados têm mais gente com Bolsa Família do que empregados/
[3] IPEA – Retrato das desigualdades
[4 Le Monde -] Au Brésil, le travail informel persiste, en dépit de la baisse du chômage
[5] https://tratabrasil.org.br/principais-estatisticas/agua/
[6] https://tratabrasil.org.br/principais-estatisticas/esgoto/
[7] Transparency International – Corruption Perception Index
[8] Transparency International – Brasil registra pior nota e pior posição da série histórica do Índice de Percepção da Corrupção
[9] Globo.com – Brazil falls in Transparency International’s corruption perception ranking
Citations
(p. 8)
Dans le pays que je vis, les Pays-Bas, une personne qui bénéficie de l’aide sociale dispose de plus d’argent qu’un Néerlandais moyen en 1950 et de quatre fois plus qu’aux temps glorieux où la Hollande régnait sur les sept mers (2)
(2) Aux Pays-Bas, une personne sans-abri reçoit environ 10000 $ par an en aides gouvernementales.
(p. 12)
Ce qui était science-fiction devient fait scientifique. Les premières voitures sans chauffeur s’engagent déjà sur les routes. À l’heure où j’écris, des imprimantes 3D produisent des structures cellulaires embryonnaires complètes et des gens équipés d’implants cérébraux actionnent des bras robotiques par la seule force de leur esprit. Et ce n’est pas tout : depuis 1980, le prix du watt d’énergie solaire a plongé de 90 %… Non, ce n’est pas une erreur typographique : Avec un peu de chance, imprimantes 3D et panneaux solaires rendront possible l’idéal de Karl Marx (le contrôle des moyens de production par les masses), sans s’appuyer sur une révolution sanglante.
NDL. – juste ça : des panneaux solaires et des imprimantes 3D… 😎

