Max Hastings – La Division Das Reich : Tulle, Oradour-sur-Glane, Normandie
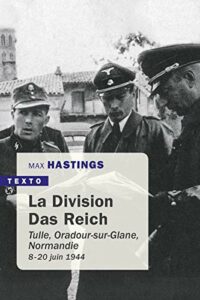
Ce livre raconte la traversée, heureusement, pleine d’embûches de la Division Das Reich pour aller de Montauban jusqu’à la Normandie. Cette division a été appelée en renfort des forces allemandes lors du débarquement du 6 juin 1944.
On a beaucoup parle des deux grands massacres pratiqués par cette division : Tulle – 99 pendus devant la population convoquée – et Oradour-sur-Glane – toute la population assassinée – mais il y a eu plusieurs autres.
Pour simplifier, ces massacres sont arrivés surtout en représailles des actions de la résistance : sabotages ou embuscades dans le but de bloquer ou, au moins, retarder l’avancement de la Division. Et, effectivement, il semblerait que la résistance a diminué le rythme après le massacre d’Oradour-sur-Glane.
Ce récit met en valeur les moindres détails de comment tout s’est passé. En particulier la mésentente entre le FTP (Franc-Tireurs et Partisans – les communistes) et l’AS (Armée Secrète). Les premiers se sentaient autonomes et n’obéissaient les ordres arrivant de l’Angleterre (de Gaulle). Cette mésentente, dans un sens plus global de la deuxième guerre m’intéresserait, mais pas encore trouvé une source satisfaisante.
À la fin du livre il y a une discussion sur quelques controverses historiques. Est-ce que le retard imposé à l’avancée de la Division Das Reich a réellement changé le cours de l’histoire du débarquement ? Il semblerait que pas forcément et que la percée des alliés serait juste retardée. Ou alors, est-ce que les pertes humaines étaient justifiées ? Certains ont estimé tout à fait légitimes les représailles allemandes vu qu’il avait encore une Occupation (voir citations).
Ce livre a été écrit en 1982 et ré-édité mais, semble-t-il, sans grandes modifications. Peut-être que des nouvelles informations ont pu être disponibles depuis. L’auteur reconnaît que certaines questions restent et resteront sans réponse.
En plus des sources d’informations officielles disponibles à l’époque l’auteur a pu s’entretenir personnellement avec des acteurs, aussi bien français mais aussi des membres de la Division Das Reich encore envie dans les années 80 (ceux qui ont accepter d’en parler) et cela donne une toute autre dimension à cet ouvrage.
Citations
(p. 183)
CITOYENS DE TULLE!
Quarante soldats allemands ont été assassinés de la façon la plus abominable par les bandes communistes. La population paisible » a subi la terreur. Les autorités militaires ne désirent que l’ordre et la tranquillité. La population loyale de la ville le désire également. La façon affreuse et lâche avec laquelle les soldats allemands ont été tués prouve que les éléments du communisme destructeur sont à l’œuvre. Il est for regrettable qu’il y ait eu aussi des agents de police ou des gendarmes français qui, en abandonnant leur poste, n’ont pas suivi la consigne donnée et ont fait cause commune avec les communistes.
Pour les maquis et ceux qui les aident, il n’y a qu’une peine, le supplice de la pendaison. Ils ne connaissent pas le combat ouvert, ils n’ont pas le sentiment de l’honneur. 40 soldats allemands ont été assassinés par le maquis. 120 maquis ou leurs complices seront pendus. Leurs corps seront jetés dans le fleuve.
A l’avenir, pour chaque soldat allemand qui sera blessé, trois maquis seront pendus; pour chaque soldat allemand qui sera assassiné, dix maquis ou un nombre égal de leurs complices seront pendus également.
J’exige la collaboration loyale de la population civile pour combattre efficacement l’ennemi commun, les bandes communistes.
Tulle, le 9 juin 1944
Le général commandant les troupes allemandes
(p. 227-228)
Le maire (de la commune de Terrasson) soulagé, comme ses administrés, allait pouvoir à nouveau faire, le 13 juin, un compte rendu des événements :
« Je profite d’un train blindé allant à Périgueux pour expédier cette lettre. Nous avons vu des horreurs; Nous sommes sains et saufs mais le prix est terrible : quatre tués, trois blessés, , la mairie incendiée, huit maisons détruites par les flammes ou l’artillerie, la population terrorisée. Nous avons vécu deux heures épouvantables, tous les habitants entassés sur la place, des mitrailleuses braquées sur eux, un homme pendu au balcon de la maison contiguë… Je ne sais Dieu comment j’ai pu conserver un calme surhumain… »
Puis après coup il écrivit encore le 9 juillet avec le recul nécessaire à plus de lucidité:
« Le cycle est simple et se reproduit chaque fois : le maquis se livre à une opération, les Allemands arrivent, le maquis s’évanouit dans les bois avec des pertes légères, la population civile trinque, les Allemands s’en vont et le maquis réapparaît. S’il y a des pertes chez les Allemands le châtiment est terrible. Il n’est vraiment pas facile, dans ces circonstances, d’être à la fois le représentant et le défenseur du peuple ! »
(p. 260)
Là, quand le grand portail se referma sur eux, quelque 400 femmes en enfants s’entassaient à l’intérieur du lieu saint, gardés par deux SS arme au point. Il s’entrouvrit pourtant encore une fois livrant le passage à un groupe de soldats qui portaient une lourde caisse. Marguerite Rouffranche se rappelle encore combien elle fut frappée de leur extrême jeunesse. Ils déposèrent leur fardeau à la croisée du transept, allumèrent un cordon qui en sortait puis s’écartèrent. Une épaisse fumée noire fusa alors de la caisse qui semblait contenir un dispositif incendiaire. Affolés, femmes et enfants se reculèrent cherchant en vain un abri en hurlant. Postés à l’extrémité ouest de l’église les soldats pointaient leurs armes tout en dégoupillant des grenades, qu’aux premiers coups de feu tirés dans les granges ils lancèrent en vidant leurs chargeurs sur les malheureux. Puis, s’apercevant que des femmes s’engouffraient dans la sacristie, quelques soldats y coururent, enfoncèrent la porte et liquidèrent les infortunées qui s’y étaient blotties. Mme Rouffranche vit tomber sa fille, tuée net. Elle se laissa choir sur le dallage et resta immobile. Deux gamins de dix et douze ans courant vers un confessionnal furent abattus à bout portant, dans la nuque. L’un des garçons Levignac, (l’autre était déjà mort dans une grange avec les hommes), le petit Dominique Forest, la petite Renaud (quatre ans), Lucien et Marcel Boulestin – que leur mère avait consciencieusement débarbouillés sous un pommier afin qu’ils soient propres pour la visite médicale – Bernadette Cordeau, Roger Joyeux (quatre ans), Henri Joyeux (cinq ans), Mme Leroy, dont les papiers étaient en règle, Mme Belivier qui avait envoyé un fils se cacher, la mère juive qui avait laissé ses enfants sous l’escalier, tous périrent cet après-midi là dans l’église avec 400 autres personnes.
Les landaus, les chaises, les confessionnaux, les murs furent criblés d’impacts de balles dans l’horrible cacophonie mêlant clameurs et détonations. Des femmes, des enfants dont les vêtements brûlaient coururent dans un indescriptible affolement en tous sens, tentant en vain de s’échapper, avant que les SS empilant paille et chaises sur les cadavres et les blessés y mettent le feu avant de se retirer.
Une femme, une seule, échappa au carnage : Mme Rouffranche. Il y avait en effet trois fenêtres derrière l’autel. S’aidant du marchepied dont l’abbé se servait pour allumer les cierges, elle se hissa sur une saillie située au -dessus et sauta par l’une d’elles. Elle tomba trois mètres plus bas et, en se relevant, aperçut une autre femme qui tentait de l’imiter. C’était Henriette Joyeux qui tenait dans ses bras son nourrisson de sept mois. Mais celui-ci lui échappa des mains et tomba. Ses cris alertèrent les Allemands qui accoururent et abattirent la mère infortunée qui retomba, morte, dans l’église. Le bébé fut lui aussi tué sur place.
(p. 328)
Le maréchal Bernard Montgomery lui-même commandant du 21ème groupd d’armées britanniques en 1944, qui combattit en 1921 les insurgés irlandais en tant que major de brigade, obéissait aux mêmes réflexes : « Toute mon attention se portait sur la défaite des rebelles, écrivit-il, et le nombre des maisons incendiées ne m’a jamais tracassé. Tout civil ou républicain, soldat ou agent de police qui s’en prend à un officier ou un soldat est fusillé sur-le-champ ». En réalité, jusqu’à ce que l’opinion publique intérieure les eût contraints à en annuler l’ordre, les Britanniques appliquèrent aux rebelles irlandais une politique de représailles officielles comportant la destruction systématique par incendie des maisons de ceux qui leur prêtaient assistance. Le général Maxwell avait fait exécuter les chefs de la révolte de 1016 et interner en Angleterre leurs partisans et, réfléchissant plus tard à son expérience irlandaise, Montgomery confirma : « A mon avis, pour gagner une guerre de ce genre il faut être sans pitié; Cromwell ou les Allemands l’auraient expédiée en cinq sec. ».
Notons d’aillers que Montgomeri n’a jamais manifesté d’intérêt ou d’estime envers les résistants français alors que le général Eisenhower en revanche, après la Libération rendit un vibrant hommage à leur contribution. Mais « Monty » a toujours en fait paru garder l’aversion du soldat de métier pour les irréguliers quelle que fût la cause de leur combat. Peut-être même s’est-il sournoisement et paradoxalement senti solidaire des officiers de la Wehrmacht qui, durant l’Occupation, s’étonnaient qu’on leur reprochât de fusiller des résistants armés alors que le gouvernement français avait signé un armistice avec l’Allemagne.
Quatrième de couverture
8 juin 1944. La division Das Reich, forte de 15000 hommes, quitte Montauban en direction de la Normandie sous le commandement du général Heinz Lammerding.
Entravée dans sa progression par la Résistance, des opérations de commando et les bombardements de l’aviation alliée, elle va sur son trajet acquérir une terrible notoriété, en se livrant, à Tulle et à Oradour-sur-Glane, à deux représailles sanglantes. Ces exactions barbares allaient avoir d’importantes conséquences au niveau stratégique. Car si la division Das Reich était arrivée à temps sur les lieux du débarquement, elle aurait, sinon permis aux forces allemandes de rejeter les alliés à la mer, du moins contribué à différer l’issue de la bataille, retardant du même coup la libération rapide de la France.
Voici l’une des pages les plus douloureuses et les plus extraordinaires de la guerre secrète dont certains épisodes n’avaient encore jamais été racontés.

