Johann Chapoutot – Le grand récit
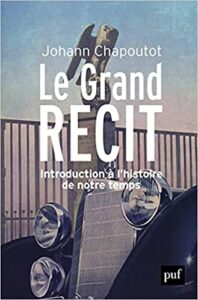 Le récit !!! Tout une histoire.
Le récit !!! Tout une histoire.
En fait, c’est le « réel imaginaire » à une époque donnée donné, à un endroit donné. Un réel imaginaire qui a mu une population dans une certaine direction.
Le livre commence par quelques grands récits : la religion (providentialisme), l’après la Grande Guerre, les nazisme et fascisme, l’eschatologie communiste, … et aussi les ismes, dont le complotisme.
Chacun de ces récits prend une trentaine de pages. Quoi ? Pas beaucoup ? En fait, Chapoutot ne récite pas l’histoire, quoi que très brièvement. Il explique les époques concernées par ces récits… comme des récits qui ont fait ces époques, comme les réels imaginaires de ces époques.
Il y a deux chapitres particuliers – « D’une voix blanche » et « Lire et vivre le temps ». Ce sont, peut-être, les chapitres les plus intéressants. Dans ces deux chapitres on apprends quels sont les moyens, les outils des historiens : les récits mais tout un tas de connaissances nécessaires au métier de historien.
Dans ce cas, j’ai interprété les autres chapitres comme des exemples de récits produits par cet historien.
On a l’habitude de lire des livres de histoire comme si tout était clair… Mais non, leur métier consiste à reconstituer non seulement les faits, mais aussi les comprendre, le contexte, le comment, le pourquoi. Pour cela, ils se basent sur les récits connus (documents), mais aussi des connaissances en philosophie, linguistique, anthropologie, psychologie, … Le métier de historien est un métier multidisciplinaire, qui me semble de plus en plus passionnant.
Du coup, on comprends mieux la démarche de Chapoutot dans ses livres précédents et même, si j’ose le dire, la grande maturation de l’auteur en tant que Historien (avec un H majuscule). Dans ce livre, on peut se rendre compte de l’étendue des connaissances multidisciplinaires en place.
Citations
(p. 15-16)
Un récit, ou une « histoire », c’est le langage qui se saisit du « réel » et qui informe, lui donne forme, à tel point que l’on puisse douter que le réel existe en dehors de lui, tant on le vit et on le pense à travers les catégories du langage, avec les ressources et les lacunes de la langue, ressources et lacunes déterminées géographiquement, socialement et historiquement. On ne voit jamais le réel qu’à travers le prisme de la langue et de tout ce qu’elle charrie comme réminiscences culturelles, réseaux métaphysiques et stéréotypes.
(p.266)
Frankfurt, note que « l’un des traits les plus caractéristiques de notre culture est l’omniprésence du baratin »:
Le domaine de la publicité, celui des relations publiques, et celui de la politique, aujourd’hui étroitement lié aux deux précédents abondent en conneries si totales et absolues qu’elles constituent de véritables modèles classiques de ce concept.
Harry Frankfurt, De l’art de dire des conneries, Paris, 10/18, 2006
(p. 270)
Le bullshitisme est consubstantiellement lié au managérialisme, ce langage du vide, cette nouvelle langue de bois emphatique, voire enthousiaste et parfaitement vaine, qui est aussi une conception de l’homme et du groupe humain, de la cité, donc de la politique, qui conçoit le réel en termes de calcul optimisateurs, de kits, de process et de nudge.
(p.300)
La langue allemande est ainsi faite, montre Wismann, que l’on est bien obligé d’écouter son interlocuteur jusqu’au terme de sa phrase. C’est bien déplaisant, car on ne peut plus converser à la française, à sauts et gambades, par jaillissements et interruptions. En Allemagne, Mme de Staël « regrette les gazouillis de [s]on salon. On y parle tous en même temps, et tout le monde s’entend », alors que les soirées allemandes ressemblent à des colloques universitaires. C’est terrible : on doit écouter l’autre !
(p. 318)
Quant à comprendre, ce mode d’élucidation propre aux « sciences de l’esprit », par opposition à l’explication des « sciences de la nature », cela apparaît bien difficile. Marc Bloch, en pleine Seconde Guerre mondiale, alors que, Juif et résistant, il est traqué par les nazis, écrit, dans « Apologie pour l’histoire », que la vocation de l’historien est de comprendre et non de juger. Comprendre – mot magnifique – et non qualifier, absoudre ou condamner, avec la suffisance du tard-venu et la bouffissure de l’anachronique impénitent. Mais comprendre les nazis ?…
Un mot, pour tout dire, domine et illumine nos études : comprendre [..]. Mot surtout chargé d’amitié. Jusque dans l’action, nous jugeons beaucoup. Nous ne comprenons jamais assez.
(p. 335-335)
Le monde stupide et étouffant du PC de l’Union Soviétique, combien de nos contemporains le reconnaîtrons dans leur entreprise ou dans ces administrations qui, pour se « moderniser », importent servilement tout ce qui ne fonctionne pas dans le « privé » ? Lieux de travail, lieux de souffrances psychosociales avérées et massives, lieux où, selon l’expression consacrée, on per sa vie à tenter de la gagner.
Quatrième de couverture
La « quête de sens » est devenue un commerce de « psys » et de « coachs ». C’était jadis l’affaire de théologiens, qui cherchaient la main de Dieu dans l’Histoire. Entre les Lumières (XVIIIe siècle) et la Grande Guerre (début du XXe), le théologique a cédé la place au politique : dans l’Occident du « désenchantement » (Max Weber) et du retrait de Dieu, on chercha le sens dans ces « religions séculières » (Raymond Aron) que furent le communisme, le fascisme et le nazisme, mais aussi le libéralisme et ses avatars (ultra-, néo-, …) ainsi que, toujours plus couru semble-t-il, le complotisme, depuis que les « grands récits » (Jean-François Lyotard) sont entrés en déshérence.
Chercher le sens est également une manie de historien – le sens des actes commis par les acteurs d’une époque, expressions d’une vision du monde propre à son temps, à un lieu, à un groupe humain (classe, race, nation, ou unité de police, corps de fonctionnaires, ordre religieux), qui légalise, légitime et justifie parfois le pire.
Introduction à l’histoire des XXe et XXI siècles, ce livre expose les « récits du temps » (François Hartog) qui donnent sens, substance et consistance aux individus déterminés à vivre et faire l’histoire et présente une manière de faire de l’histoire attentive aux univers mentaux et aux bonnes raisons que l’on avance toujours pour faire et défaire. Car l’histoire, au-delà de la discipline ou de la science, est un art de lire et de vivre le temps, un art littéraire sensible au cœur et à la raison.

