Gisèle Sapiro – Des mots qui tuent
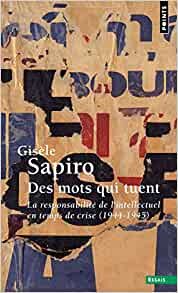
Comment et sur quelles bases s’est passée l’épuration des intellectuels à la Libération. C’est le sujet de ce livre.
Il n’a pas été aussi simple que cela. Tout d’abord, il fallait séparer ce qui était de la littérature et ce qui était de la politique (les pamphlets). Ce qui était de la liberté d’expression et ce qui était de la collaboration avec l’ennemi. Des frontières assez minces dont les défenses n’ont pas manqué d’essayer d’utiliser. L’antisémitisme ou le racisme n’étaient pas, à l’époque, considérés comme étant des crimes.
Le retour de la peine de mort, abolie en 1848, pour des crimes de trahison a été rétablie par décrets en 1939 et 1940.
Mais grosso modo, les condamnations ont été surtout décidées sur des écrits ayant donné des informations ou des avantages à l’occupant, de l’incitation à la haine provocant la désunion nationale ou alors des dénonciations nominatives dans les écrits.
Le livre décrit très longuement les nombreux procès, explicitant chaque point. C’est parfois assez long, mais la richesse de détails est assez importante même si, on se doute bien, les actes des procédures ont été bien plus fournis.
Le jugement des intellectuels a commencé dès la libération de la France, au deuxième semestre 1944. Des 55 procès, il y a eu 25 condamnations dont 10 condamnations à mort.
Il y a, dans la dernière partie, une étude assez très détaillée de la responsabilité de l’intellectuel, avec une bonne explication de la théorie sartrienne de la responsabilité de l’intellectuel.
Et on comprend alors pourquoi Sartre s’est refusé à signer des demandes de grâce à des intellectuels condamnés à mort alors que beaucoup d’autres intellectuels l’ont fait.
C’est un livre très bien écrit, avec beaucoup de notes et de références. Un peu soporifique pour mon goût mais ça vaut la peine d’insister.
Citations
(p. 9)
On a reproché à l’épuration d’avoir plus durement frappé ceux qui parlaient avec approbation du mur de l’Atlantique que ceux qui le construisaient. Je trouve parfaitement injuste qu’on ait excusé la collaboration économique mais non qu’on ait sévi contre les propagandistes d’Hitler. Par métier, par vocation, j’accorde une énorme importance aux paroles. […] Il y a des mots aussi meurtriers qu’une chambre à gaz.
Simone de Beauvoir
(p. 187)
S’ils n’avaient pas le pouvoir de faire exécuter ceux qu’ils dénonçaient, les propos des écrivains collaborationnistes tiraient leur autorité de plusieurs facteurs : leur pouvoir symbolique en tant qu’intellectuels, qui s’exerçait tant auprès du public qu’auprès des dirigeants ; leur ajustement à l’appareil répressif des forces d’occupation et d’un État autoritaire; la suppression de la liberté d’expression, qui interdisait à leurs victimes le droit de réponse et leur laissait une situation de quasi-monopole idéologique. Plutôt qu’un rapport de causalité entre les discours et les actes, il s’agit dans leur cas d’un travail de légitimation : tenant leur autorité de la conjoncture politique de l’Occupation , ils justifiaient, par leurs écrits, cette conjoncture et la violence quotidienne qui s’exerçait dans ce cadre. Ce travail de légitimation entre les intellectuels et les pouvoirs temporels avait ainsi un caractère circulaire. En s’appuyant sur ceux-ci pour réguler l’espace public, ils rompaient le pacte éthique fondateur de l’autonomie intellectuelle, qui veut que l’on s’en tienne à l’affrontement des idées, sans faire intervenir de critères ni de forces extérieurs. Ils furent bien mal placés pour revendiquer cette autonomie après l’avoir refusée à leurs confrères.
Quatrième de couverture
« Il y a des mots aussi meurtriers qu’une chambre à gaz », écrit Simone de Beauvoir pour expliquer son refus de soutenir le recours en grâce de Brasillach, condamné à mort et exécuté en 1945. Peut-on tout dire ? Et à quel prix ?
Les écrits des intellectuels ayant collaboré avec l’occupant (Maurras, Rebatet, Céline, etc.) sont ici examinés à la loupe. Comment la justice de la Libération a-t-elle défini la responsabilité de ces intellectuels ? Quels textes, quels mots ont donné prise à l’accusation d’« intelligence avec l’ennemi » et de trahison nationale ? Quels arguments les accusés et leurs défenseurs lui ont-ils opposé ?
La théorie sartrienne de la responsabilité de l’intellectuel exprime la croyance dans le pouvoir des mots qui fut au cœur de ces procès de l’Épuration – car, pour Sartre, les paroles sont des actes.

