Eva Illouz – Happycratie
Ah, l’industrie du bonheur promis…
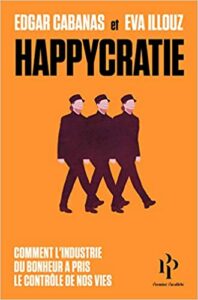
Les deux auteurs s’attachent à démonter l’idée de la « psychologie positive » comme étant plutôt un phénomène du marché du bonheur.
Difficile de trouver un point d’équilibre optimal entre l’optimisme excessif, le pessimisme excessif et le réalisme excessif. Ce livre s’attaque à la « happycratie » comme l’idéologie du bonheur. Je caricature : tout est beau, la vie est belle, il n’y a pas de problème et si on n’est pas heureux c’est parce qu’on ne regarde pas les choses du bon côté. C’est devenu le fond de commerce du développement personnel et de certaines sectes. Un vrai business.
J’adhère à la plupart des arguments. Néanmoins, il y a deux points qui me dérangent dans le contenu de ce livre.
Il y a des gens qui sont excessivement pessimistes, excessivement optimistes ou excessivement réalistes. Les « excessivement » sont, en général, des situations pathologiques. Un peu d’optimisme peut parfois faire du bien, Donc, si on enlève la partie « marché du bonheur », peut-être que la psychologie positive peut être utile à certains.
L’autre point qui me dérange, et beaucoup plus, est la mention fréquente au « néolibéralisme », presque en l’accusant d’être le coupable de l’apparition de ce marché du bonheur. Je pense que l’auteur, comme beaucoup, confond corrélation et causalité.
Il est vrai que s’il y a une demande, il y aura de l’offre. C’est un mécanisme économique archi connu, valable partout. S’il n’y avait pas des malades, la médecine n’existerait pas. C’est valable pour toute branche de la psychologie, d’ailleurs. Et aussi la psychanalyse.
Je crois voir dans les différents écrits de Eva Illouz qu’elle a une tendance politique anticapitaliste (mais je peux me tromper). Il n’y a pas de mal à être de l’un côté ou de l’autre. le problème est de ne pas laisser un biais cognitif dû à ses convictions personnelles s’insérer dans ses activités scientifiques. C’est un point très difficile à régler lorsqu’on travaille en sciences humaines, en particulier la sociologie, la philosophie et, dans ce cas, la psychologie.
Quatrième de couverture
Le bonheur se construirait, s’enseignerait et s’apprendrait : telle est l’idée à laquelle la psychologie positive, née au tournant du siècle, s’attache à conférer une légitimité scientifique. Il suffirait d’écouter les experts pour devenir heureux. L’industrie du bonheur, qui brasse des millions d’euros, affirme ainsi pouvoir façonner les individus en créatures capables de faire obstruction aux sentiments négatifs, de tirer le meilleur parti d’elles-mêmes en contrôlant totalement leurs désirs improductifs et leurs pensées défaitistes.
Mais n’aurions-nous pas affaire ici à une autre ruse destinée à nous convaincre, encore une fois, que la richesse et la pauvreté, le succès et l’échec, la santé et la maladie sont de notre seule responsabilité ? Et si la dite science du bonheur visait à nous convertir à un modèle
individualiste niant toute idée de société ?
Edgar Cabanas et Eva Illouz reconstituent ici avec brio les origines de cette nouvelle « science » et explorent les implications d’un phénomène parmi les plus captivants et inquiétants de ce début de siècle.

